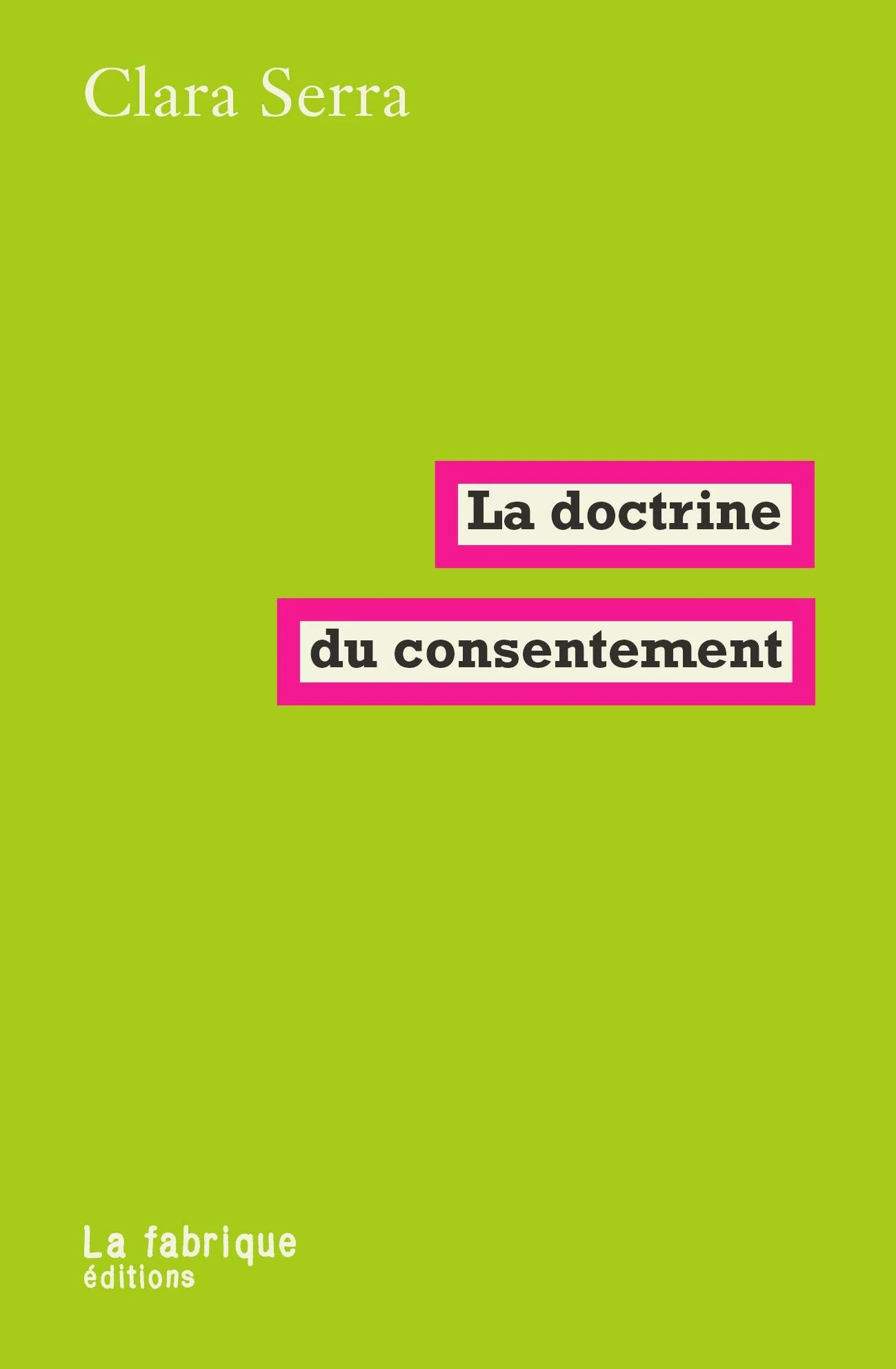À LA UNE
Du Canada aux États-Unis : Véronique Pronovost analyse l’offensive conservatrice contre l’avortement
Du Canada aux États-Unis : Véronique Pronovost analyse l’offensive conservatrice contre l’avortement
À mesure que les offensives anti-avortement s’intensifient aux États-Unis, leurs échos traversent la frontière. Au Canada, les mouvements conservateurs s’organisent, reprennent les discours, les tactiques, et cherchent à redessiner les lignes du possible.
Doctorante en sociologie et en études féministes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Véronique Pronovost est chercheure en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Depuis plus de dix ans, elle suit de près les dynamiques transnationales de l’antiféminisme conservateur en Amérique du Nord, et en particulier l’évolution du mouvement contre l’avortement. Membre de plusieurs collectifs de recherche (le Chantier sur l’antiféminisme du RéQEF, le Collectif Action Politique et Démocratie), elle siège également au comité de veille stratégique sur l’avortement piloté par la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN).
Spécialiste des interactions entre stratégie politique, discours religieux et recul des droits reproductifs, Véronique Pronovost observe avec lucidité comment une droite religieuse coordonnée impose, lentement mais sûrement, une redéfinition des normes sociales. Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 17 mars 2025 au Québec, elle éclaire les logiques à l’œuvre, la nécessité d’une vigilance constante — et l’urgence de penser la riposte, culturelle autant que politique, avant que les reculs ne deviennent irréversibles.
“Libres de choisir. Aux premières lignes de l’avortement” de Julie Boisvert et Élise Ekker-Lambert
“Libres de choisir. Aux premières lignes de l’avortement” de Julie Boisvert et Élise Ekker-Lambert
Le Canada est souvent cité comme un modèle en matière de droits reproductifs. Depuis l’arrêt Morgentaler de 1988, aucune loi ne régit l’IVG, ce qui en fait un soin de santé accessible sans restriction légale. Toutefois, cette absence de loi ne garantit pas un accès universel. L’avortement dépend du réseau de soins et de la volonté des provinces de financer les services.
En conséquence, les disparités d’accès sont énormes. À Montréal, une femme peut avorter rapidement, mais dans certaines régions du Québec et du Canada, il faut parcourir des centaines de kilomètres et attendre plusieurs semaines. Jusqu’à récemment, dans des provinces comme le Nouveau-Brunswick, les cliniques privées n’étaient pas financées par le gouvernement, ce qui rendait l’IVG largement inaccessible aux personnes les plus précaires. Depuis un changement de gouvernement en novembre 2024, cette politique a été modifiée, et l’assurance maladie couvre désormais l’IVG en clinique privée — une avancée importante pour le droit à l’avortement dans la province.
L’avortement reste aussi une cible des mouvements conservateurs. Depuis l’annulation de Roe v. Wade aux États-Unis en 2022, les groupes anti-choix québécois et canadiens ont intensifié leurs actions : désinformation, manifestations, pressions politiques.
C’est dans ce contexte que s’inscrit Libres de choisir. Aux premières lignes de l’avortement (2025), un documentaire réalisé par Julie Boisvert et Élise Ekker-Lambert. En s’immergeant dans les cliniques québécoises et canadiennes, elles donnent la parole aux soignantes et aux patientes, exposant les réalités concrètes de l’IVG. Un regard féministe et engagé, qui interroge aussi l’évolution du débat sur l’avortement et la montée des mouvements anti-choix.
Enflammé.e.s a rencontré les réalisatrices le 13 mars 2025 dans les locaux de la nouvelle Maison de Radio-Canada.
Marie Docher : pourquoi les lesbiennes sont-elles invisibles ?
Marie Docher : pourquoi les lesbiennes sont-elles invisibles ?
Le 21 mars 2025, Marie Docher publie Pourquoi les lesbiennes sont invisibles, un ouvrage incisif qui analyse en profondeur l’effacement des lesbiennes dans l’espace public, culturel et intellectuel. Photographe, réalisatrice et militante féministe, elle consacre son travail à rendre visibles celles que l’histoire, les médias et les institutions relèguent à la marge. Lauréate de la grande commande photographique de la Bibliothèque nationale de France La France sous leurs yeux, elle a aussi cofondé LaPartDesFemmes, un collectif engagé pour la reconnaissance des femmes dans la photographie. En 2021, elle est nommée chevaleresse des Arts et Lettres, une distinction qui contraste avec la réalité d’un milieu où les lesbiennes restent largement marginalisées et sous-financées.
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 12 mars 2025, Marie Docher décrypte les mécanismes d’invisibilisation analysés dans son livre : désintérêt institutionnel, résistances culturelles, plafonds de verre et silences médiatiques. Elle revient sur le manque de reconnaissance des artistes lesbiennes, la censure numérique, et les menaces que font peser les politiques réactionnaires sur leurs droits. Alors que l’Observatoire de l’égalité dans la culture met en lumière des inégalités persistantes, elle interroge les stratégies à adopter pour briser ce cycle d’effacement et imposer la visibilité lesbienne.
Le féminisme d’État en France et au Québec : bilan d’un demi-siècle d’institutionnalisation avec Anne Revillard
Le féminisme d’État en France et au Québec : bilan d’un demi-siècle d’institutionnalisation avec Anne Revillard
Le 4 mars 2025, Enflammé.e.s a rencontré Anne Revillard, professeure de sociologie à Sciences Po, chercheuse spécialiste des politiques publiques d’égalité et directrice du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP). Elle est également membre du Centre de recherche sur les inégalités sociales (CRIS) et s’est distinguée par ses travaux sur l’articulation entre droit, action publique et transformations des inégalités de genre et de handicap.
En 2016, elle a publié La cause des femmes dans l’État. Une comparaison France-Québec aux Presses universitaires de Grenoble, un ouvrage qui fait aujourd’hui référence sur la manière dont les institutions publiques ont intégré – ou non – les revendications féministes des années 1960 aux années 2010. À travers une approche comparative, elle y analyse la construction du féminisme d’État en France et au Québec, ainsi que la capacité de ces institutions à défendre les droits des femmes face aux résistances politiques et administratives.
Si elle a cessé de travailler sur ces questions depuis une dizaine d’années, son regard historique permet de revenir sur des décennies de luttes pour l’égalité. Comment ces institutions ont-elles émergé sous l’impulsion des mouvements féministes ? Quels leviers ont-elles pu mobiliser pour influer sur les politiques publiques ? Face aux alternances politiques et aux résistances institutionnelles, ont-elles réussi à imposer la cause des femmes au sein de l’État ?
Dans cet entretien, elle revient sur son travail, les dynamiques qui ont structuré le féminisme d’État, et les leçons que l’on peut tirer aujourd’hui de cette institutionnalisation des luttes féministes. Une plongée passionnante dans les coulisses des politiques publiques féministes.
Cartographier la montée du masculinisme en Europe : le projet de l’ISD primé
Cartographier la haine : la montée du masculinisme et son rôle dans la radicalisation en ligne
Le 11 février 2025, à l’École Normale Supérieure, dans le cadre du Sommet international pour l’action sur l’intelligence artificielle organisé par la France et l’Inde (6-11 février 2025), le Laboratoire pour les droits des femmes en ligne a dévoilé les lauréats de son tout premier appel à projets. Parmi eux, un projet porté par l’Institute for Strategic Dialogue (ISD) : Mapping the Masculinist and Male Supremacist Landscape in Central and Eastern Europe.
Depuis sa création en 2006, l’ISD est un laboratoire d’idées international spécialisé dans l’analyse et la lutte contre l’extrémisme, la désinformation et la polarisation numérique. Depuis plusieurs années, ses recherches mettent en lumière le rôle central des idéologies masculinistes dans les dynamiques de radicalisation en ligne.
Chercheuse à l’ISD, Cécile Simmons se consacre à l’étude des stratégies de manipulation en ligne, des mouvements d’extrême droite et de la violence numérique genrée. Son travail, largement cité dans les médias anglophones et francophones, a contribué à documenter la manière dont la misogynie structure de nombreux discours de haine.
Le 21 février 2025, Enflammé.e.s l’a rencontrée pour discuter de l’importance de cartographier les réseaux masculinistes en Europe de l’Est, mais aussi des conclusions de deux rapports majeurs de l’ISD : Misogynistic Pathways to Radicalisation, qui explore les liens entre misogynie et terrorisme, et Web of Hate, une étude rétrospective des vagues de violence sexiste en ligne.
Inégalités de genre : des écarts persistants malgré des progrès réels
Inégalités de genre : des écarts persistants malgré des progrès réels
Depuis 2003, l’Observatoire des inégalités analyse, mesure et documente les inégalités, notamment les écarts entre les femmes et les hommes en France. Éducation, emploi, répartition des tâches domestiques, accès aux postes à responsabilité : si des progrès ont été réalisés, l’égalité reste encore un horizon lointain.
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 21 février 2025, Anne Brunner, co-directrice des rapports de l’Observatoire, revient sur les avancées et les blocages persistants. Pourquoi les écarts salariaux perdurent-ils malgré des décennies de politiques publiques ? Comment expliquer que la maternité pénalise encore autant les carrières féminines ? Quels leviers faut-il actionner pour une transformation durable des mentalités et des structures ?
Entre constats chiffrés et pistes d’action concrètes, Anne Brunner nous invite à repenser les moyens d’accélérer le changement, afin que l’égalité entre les femmes et les hommes ne soit plus un objectif lointain, mais une réalité tangible.
Bérangère Couillard : les chantiers du HCE pour l’égalité femmes-hommes
Bérangère Couillard : les chantiers du HCE pour l’égalité femmes-hommes
Chaque année, le 8 mars est un moment de mobilisation où se mesurent les avancées et les combats encore à mener pour les droits des femmes. En 2025, l’ONU a choisi pour thème « Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation », un appel à renforcer les droits des femmes dans toutes leurs diversités.
À l’approche de cette journée où collectifs féministes et syndicats appellent à une grève féministe, la question reste entière : où en est réellement l’égalité en France ?
Sept mois après sa nomination à la tête du Haut Conseil à l’Égalité (HCE), Enflammé.e.s a rencontré Bérangère Couillard à l’Hôtel du Petit Monaco le 18 février 2025. L’occasion de revenir sur les grands dossiers qu’elle porte et les défis qui restent à relever : le poids de la France dans la diplomatie féministe, les inégalités professionnelles persistantes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Quels combats doivent être menés en priorité ? Bérangère Couillard dresse un état des lieux et esquisse les prochaines batailles à mener.
Clara Serra : les limites de la notion de consentement
Clara Serra : les limites de la notion de consentement
Alors que la France s’apprête à examiner une proposition de loi visant à inscrire l’absence de consentement dans la définition du viol, Clara Serra, philosophe et militante féministe espagnole, met en garde contre une illusion : celle de croire qu’un simple mot, gravé dans le droit, suffirait à transformer la réalité des violences sexuelles. Dans La Doctrine du consentement (Éditions La Fabrique, 2025), elle déconstruit l’idée d’un consentement conçu comme une solution universelle, un remède à toutes les oppressions, et rappelle que son rôle est d’abord juridique : délimiter la violence, non garantir des relations libres, désirées et égalitaires.
Alors que les députées Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin défendent une réforme qui se veut ambitieuse, Clara Serra invite à un débat plus vaste : quelle place donnons-nous réellement à la parole des femmes ? Comment éviter de faire du consentement un fétiche qui occulterait les rapports de pouvoir ? Que reste-t-il à combattre une fois la loi votée ?
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 18 février 2025, elle démonte les mirages du seul oui est oui et plaide pour une révolution qui dépasse les frontières du droit pénal.
Justice restaurative : repenser la réparation au cœur du système judiciaire
Justice restaurative : repenser la réparation au cœur du système judiciaire
Magistrat, docteur en droit, ancien juge des enfants et ex-secrétaire général de l’Institut des Hautes Études sur la Justice, Antoine Garapon a également été membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) de 2019 à 2021. Aujourd’hui président de la Commission Reconnaissance et Réparation (CRR), il continue de repenser en profondeur le rôle de la justice.
Dans son ouvrage Pour une autre justice : La voie restaurative (Éditions PUF, 2025) il met en lumière les limites de la justice punitive et l’urgence d’un système fondé sur la réparation. Il s’interroge sur les mécanismes institutionnels qui prolongent les souffrances des victimes et propose une approche visant à leur rendre la capacité de se reconstruire. Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 7 février 2025, il partage sa vision d’une justice qui prend pleinement en compte l’expérience des victimes.
“Socorristas” : la force d’un réseau féministe pour le droit à l’avortement en Argentine
“Socorristas” : la force d’un réseau féministe pour le droit à l’avortement en Argentine
Dans un entretien accordé à Enflammé.e.s le 28 janvier 2025, Caroline Kim Morange raconte son immersion au cœur du militantisme féministe à Córdoba, en Argentine, dans son documentaire Socorristas (2022). Entre 2018 et 2020, l’avortement y était encore largement interdit, sauf en cas de viol ou de danger grave pour la santé. Dans ce contexte, les Socorristas, un collectif de militantes, se sont organisées pour accompagner les femmes souhaitant avorter, leur apportant soutien, écoute et informations essentielles, tout en restant dans les limites légales de la transmission d'informations.
Reconnues à leurs foulards verts, symbole emblématique de la lutte pour l’avortement dans toute l’Amérique latine, ces activistes, surnommées les « secouristes », font partie d’un vaste réseau nommé Socorristas en red. À Córdoba, leur groupe, Socorristas Córdoba Hilando, rassemble étudiantes et femmes actives qui, par des permanences d’écoute, des ateliers d’information et un suivi à distance, accompagnent les femmes pour garantir des avortements aussi sûrs que possible.
Caroline Kim Morange, installée alors à Córdoba, a suivi leur combat quotidien. À travers ce film, elle éclaire la solidarité et la sororité qui structurent ce réseau féministe. Elle offre ainsi le témoignage d’un combat universel : celui des femmes qui revendiquent, face à des lois oppressives, le droit de disposer librement de leur corps.
Neil Datta : la toute-puissance des mouvements anti-choix révélée
Neil Datta : la toute-puissance des mouvements anti-choix révélée
Neil Datta, directeur exécutif du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs, a accordé une interview exclusive à Enflammé.e.s le 30 janvier 2025, depuis le siège du Forum à Bruxelles. Il y dévoile les stratégies transnationales des réseaux conservateurs anti-genre, qui s’organisent pour affaiblir les droits sexuels et reproductifs en Europe.
Avec des financements issus des États-Unis, de la Russie et de grandes fortunes européennes, ces mouvements investissent les institutions politiques et médiatiques à travers des campagnes de lobbying et de désinformation.
Face à cette menace transnationale, exacerbée par le retour de Donald Trump, Neil Datta propose une contre-offensive en cinq étapes pour protéger ces droits fondamentaux. Une bataille cruciale pour préserver nos libertés et la stabilité de nos démocraties.
Léa Veinstein : “Il suffit d'écouter les femmes” pour comprendre l'histoire de l'avortement clandestin
Léa Veinstein : “Il suffit d'écouter les femmes” pour comprendre l'histoire de l'avortement clandestin
À l’occasion des cinquante ans de la loi Veil, qui a légalisé l’interruption volontaire de grossesse en France le 17 janvier 1975, Léa Veinstein explore la mémoire des avortements clandestins dans son livre Il suffit d’écouter les femmes (Éditions Flammarion, 2025). Fruit d’une vaste collecte de témoignages orchestrée par l’Institut national de l’audiovisuel (INA), ce projet donne la parole à celles qui, avant la légalisation, ont traversé la solitude, la peur, et parfois la sororité dans des réseaux d’entraide.
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 28 janvier 2025, Léa Veinstein revient sur la genèse du livre, la puissance des récits recueillis et l’impact de cette transmission intergénérationnelle. Elle évoque également le rôle de personnalités telles que Christiane Taubira, qui a témoigné dans le documentaire diffusé sur France 5, et partage sa vision de la responsabilité féministe face aux régressions actuelles.
“Sociologie de l’avortement” : des luttes historiques aux enjeux contemporains
Sociologie de l’avortement : des luttes historiques aux enjeux contemporains
Le 17 janvier 2025 a marqué le 50ᵉ anniversaire de la promulgation de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en France, plus connue sous le nom de « loi Veil ».
Marie Mathieu, sociologue, post-doctorante au Cermes3 (Centre de recherche médecine, science, santé, santé mentale, société), et Laurine Thizy, professeure agrégée de sciences économiques et sociales et docteure en sociologie à l’université Paris 8, ont exploré les multiples dimensions de l’avortement dans Sociologie de l’avortement (Éditions La Découverte, 2023). Elles y examinent les évolutions légales, les résistances sociales et politiques, ainsi que les réalités concrètes vécues par les femmes.
Dans cette interview accordée à Enflammé.e.s le 23 janvier 2025, les sociologues reviennent sur les dynamiques historiques, les inégalités territoriales et les défis actuels liés à l’accès à l’IVG, en France et ailleurs.
Intelligence artificielle et égalité femmes-hommes : danger ou opportunité ?
Intelligence artificielle et égalité femmes-hommes : danger ou opportunité ?
Le 14 janvier 2025, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), troisième assemblée constitutionnelle de la République française, a adopté l’avis « Pour une IA au service de l'intérêt général ». Composé de 175 membres représentant la société civile organisée — syndicats, associations, organisations patronales, ONG —, le CESE conseille le Gouvernement et le Parlement en matière de politiques publiques économiques, sociales et environnementales. En annexe de cet avis, la contribution de la Délégation aux droits des Femmes et à l’Égalité ainsi que la Commission Travail et emploi mettent en lumière les dangers et opportunités de l’intelligence artificielle pour les femmes et l’égalité des droits.
Le 24 janvier 2025, Enflammé.e.s a interviewé Fabienne Tatot, membre de cette délégation, et Christelle Caillet, de la Commission Travail et emploi. Dans cet entretien croisé, elles analysent les biais algorithmiques, les discriminations dans le recrutement et les stéréotypes renforcés par l’IA, tout en soulignant les conditions nécessaires pour en faire un levier d’émancipation. De la sous-représentation des femmes dans le numérique aux propositions concrètes pour encadrer l’usage de l’IA, elles appellent à une mobilisation politique et sociétale forte.
Diplomatie féministe française : aller au-delà des éléments de langage
Diplomatie féministe française : aller au-delà des éléments de langage
Le 10 janvier 2025, Enflammé.e.s a rencontré Lucie Daniel, responsable de plaidoyer et d’études pour Equipop, pour discuter du document de positionnement publié par l’association en novembre 2024 : « Diplomatie féministe » française : maintenir les exigences dans un contexte de backlash. Lors de cet entretien, Lucie Daniel analyse les fondements de la diplomatie féministe, les défis qu’elle soulève en France, ainsi que les enjeux internationaux dans un contexte marqué par la montée des mouvements anti-droits. Elle explore également les impacts d’un possible retour du Global Gag Rule sous une administration Trump II et l’importance de la 4e conférence internationale sur les politiques étrangères féministes, que la France accueillera en 2025.
Déjà interviewée par Enflammé.e.s le 11 décembre 2024, Lucie Daniel avait alors alerté sur l’impact des discours d’extrême droite sur les droits des femmes. Ce nouvel échange offre un éclairage approfondi sur les solutions à mettre en œuvre pour préserver une diplomatie féministe cohérente et ambitieuse.
Créée en 1993, Equipop est une association féministe de solidarité internationale engagée dans la défense des droits des femmes et des filles. L’association met un accent particulier sur leurs droits sexuels et reproductifs, tout en intégrant l’intersectionnalité et l’approche genre au cœur de ses actions. En collaboration avec de nombreux partenaires, Equipop répond aux défis locaux et internationaux pour faire progresser l’égalité de genre.
Cécile Thomé : la contraception, accélérateur d’inégalités
Cécile Thomé : la contraception, accélérateur d’inégalités
Le 16 janvier 2025, à la veille du 50ᵉ anniversaire de la loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse, Enflammé.e.s a rencontré Cécile Thomé, sociologue et chargée de recherche au CNRS.
Dans son livre Des corps disponibles. Comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle (Éditions La Découverte, 2024), elle explore comment la contraception, loin d’être une simple révolution libératrice, s’est imposée comme un travail genré pesant essentiellement sur les femmes. Entre critique des normes sociales et analyse historique, Cécile Thomé revient sur les enjeux contemporains de la santé sexuelle.
Isabelle Gillette-Faye : un combat contre les mutilations sexuelles
Isabelle Gillette-Faye : un combat contre les mutilations sexuelles
La journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations sexuelles féminines aura lieu le 6 février 2025. Isabelle Gillette-Faye, directrice générale de la Fédération Nationale GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants) depuis 1990, nous éclaire sur les combats actuels pour éradiquer cette pratique.
Tandis que 230 millions de femmes dans le monde en ont déjà été victimes et que 68 millions de filles risquent de l’être d’ici 2030, la France s’apprête à lancer un plan régional inédit en Île-de-France pour intensifier la lutte contre ces violences.
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 8 janvier 2025, Isabelle revient sur la médicalisation des MSF, les mariages forcés et l’éducation au consentement, tout en appelant à une mobilisation collective pour défendre les droits des femmes et des filles à l’échelle mondiale.
Pauline Delage : préserver les droits des femmes au-delà des luttes élitistes
Pauline Delage : préserver les droits des femmes au-delà des luttes élitistes
Pauline Delage, sociologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), rattachée au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (Cresppa-CSU), explore les fragilités des droits des femmes dans une société marquée par des réformes néolibérales et des discours réactionnaires. Dans son ouvrage Droits des femmes. Tout peut disparaître (Éditions Textuel, 2018), elle décrypte les inégalités structurelles et les résistances à l’égalité.
Pour Enflammé.e.s le 7 janvier 2025, elle revient sur les enjeux actuels et les défis à venir pour des féminismes inclusifs et intersectionnels.
Catherine Le Magueresse : inscrire le consentement dans la législation française en matière de viol pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles
Catherine Le Magueresse : inscrire le consentement dans la législation française en matière de viol pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles
Juriste, Catherine Le Magueresse explore les failles du droit pénal français face aux violences sexuelles. Ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), chercheuse et autrice du livre Les Pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel (Éditions iXe, 2021), elle plaide pour une réforme législative de la définition du viol, centrée sur un consentement explicite et positif.
Le 19 décembre 2024, une nouvelle proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale, visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Le texte précise qu’« il n’y a pas de consentement libre et éclairé lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant volontairement d’une situation de vulnérabilité de la victime que l’auteur ne pouvait raisonnablement ignorer, due notamment à un état de peur, de sidération, d’emprise ou à l’influence de toute substance ayant pour effet d’altérer le libre arbitre. »
Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le lendemain, Catherine Le Magueresse analyse les résistances institutionnelles, culturelles et politiques qui freinent ce changement, tout en soulignant l’importance de cette avancée législative pour mieux protéger les victimes.
Fiona Texeire : l’urgence d’un électrochoc contre les violences sexistes et sexuelles en politique
Fiona Texeire, consultante, formatrice et conférencière, est à l’initiative du #MeToo politique en France et a cofondé l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique en novembre 2021, aux côtés d’Alice Coffin, Madeline Da Silva, Hélène Goutany et Mathilde Viot.
Forte de quinze ans d’expérience comme collaboratrice d’élue.s, elle a fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles un combat central, notamment en dénonçant les mécanismes d’impunité et le manque de volonté politique pour y mettre fin. Alors que Gérald Darmanin, accusé de viol en 2017, vient d’être nommé ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement François Bayrou le 23 décembre 2024, cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 18 décembre résonne avec une acuité particulière. Cette nomination intervient alors que François Bayrou, lui-même garde des Sceaux en mai 2017, avait reçu à l’époque une lettre visant Darmanin « l’accusant d’abus de faiblesse, d’abus de pouvoir, voire de viol » (Le Monde ; France Info), alors fraîchement nommé au gouvernement d’Édouard Philippe*.
Dans cette interview, Fiona Texeire analyse l’absence de réformes structurelles, les contradictions des partis politiques, et appelle à des mesures concrètes pour garantir aux femmes une égalité réelle dans l’accès et l’exercice du pouvoir.